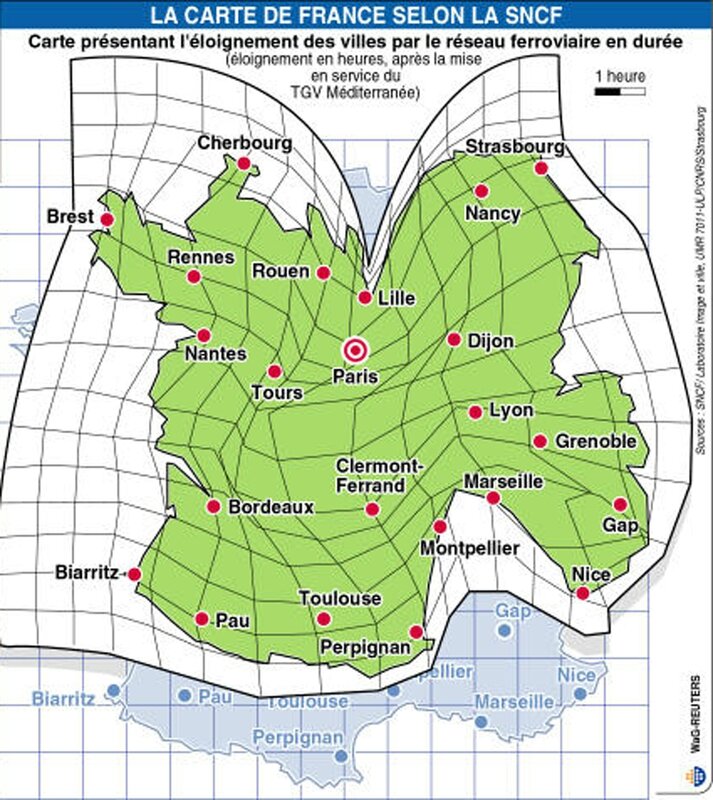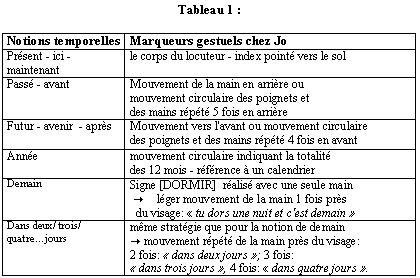L’empathie de la non-vie (1)
Design-on l’ennemi
Le design, c’est cool, c’est sympa, n’est-ce pas ? C’est Trendy diront certains pour être dans le coup. Ça rime avec le beau, l’innovation, le progrès. Parfois il y a un petit côté fascinant, magique dirons-nous. Si ça va trop loin alors c’est de la science-fiction, «mais c’est avant tout pour poser des questions» répondront les naïfs la bouche en cœur. Un concept fourre-tout : design environnemental, design commercial, design social, design numérique, design humanitaire… Bref, rien de bien méchant dans ce «quelque chose perdu entre l’art et l’industrie» que nul ne sait trop définir avec précision. Nous allons donc tenter d’expliquer, ici, ce que recouvre ce terme et ce qu’il implique réellement sur et dans nos vies.
Un projet totalitaire
L’anglicisme design, issu du vieux français desseing (1556), conjugue en son sein deux concepts : le dessin et le dessein. C’est-à-dire qu’il est une représentation mais également un projet qui nous parle de notre présent (tel un miroir) et nous permet de saisir ce qui se dessine (ou se projette) dans un futur plus ou moins proche. Le design est donc un projet ; un projet de vie, ajouterons-nous pour être plus exact. Il est considéré comme l’un des grands métiers de la conception avec ceux de l’urbaniste et de l’ingénieur (2). Tous des métiers totalitaires car totalisants : ils inventent, façonnent, gèrent, rationalisent, planifient et s’imposent à nous, sur nos vies, sans que nous leur ayons demandé quoi que ce soit. Le design n’est pas neutre mais bien notoirement politique ; et ce d’autant plus qu’il flirte constamment avec la domination et qu’il glorifie perpétuellement le système technico-logisticien.
Le design est né au XIXe siècle avec la révolution industrielle, processus historique, qui a fait basculer radicalement les sociétés d’un statut à dominante agraire et artisanal vers un statut commercial et mécanisé, statut qui va forger (renforcer et accroître) à son tour la domination capitaliste, et déposséder progressivement les sans-pouvoirs de la maigre prise qu’ils pouvaient encore avoir sur le monde et son décors. Ainsi le design prend-il son essor dans les puissances capitalistes et impérialistes de l’époque : la Grande-Bretagne et la France, avant l’Allemagne et les États-Unis. A l’origine du design, nous retrouvons la conjugaison de certains mouvements artistiques qui ont tenté de critiquer la montée de l’industrialisation. Si l’industrialisation impliquait une modification accélérée de leur environnement et des rapports sociaux, ces mouvements artistiques avaient en germe une certaine mission émancipatrice. Ils ont, d’une certaine façon, essayé de rendre, au moins partiellement, plus vivable le monde tel qu’il était en le délivrant de l’ennui d’une réalité quotidienne déjà de plus en plus envahie par la marchandise. Ainsi, face à la concentration des individus (population ouvrière) dans les villes et les usines, avec leur lot de misère et d’environnement noirâtre, l’Art & Craft tentera d’améliorer le quotidien de l’ouvrier en lui créant un espace de vie agréable et beau (la maison et l’ensemble des objets qui la meublent), mais aussi en lui proposant un retour à la nature et la réappropriation d’un certain savoir-faire (l’artisanat). Toutefois, si à sa manière ce mouvement critiquait bel et bien le nouveau système de production, il ne manquait toutefois pas de s’y associer en rapprochant les Beaux-Arts et l’industrie, par le biais des Arts appliqués. Les mouvements qui suivront – Art nouveau, Bahaus et la plupart des avant-gardes artistiques du vingtième siècle – ne cesseront dès lors de mener cette danse entre répulsion et attirance où vont s’échafauder des concepts abstraits qui, aisément récupérables et aisément récupérés par le système, n’omettront pas d’aggraver l’immondisme ambiant : telle l’idée d’Art total qui s’applique à tous les aspects de la vie, quoique la plupart de ces mouvements avant-gardistes aient d’abord voulu tout autre chose. Le design, lui, poursuivra son avancée avec les crises économiques, la société de consommation et les nouvelles technologies. Quant aux artistes, ils ne cesseront d’accroître leur connivence, voire leur entier ralliement, avec le système capitaliste industriel, ce que montre assez bien aujourd’hui le misérable spectacle que nous offre le (pseudo)-art contemporain. Deux exemples frappants et significatifs : – Le designer Brooks Stevens qui popularise, dans les années 50, la notion « d’obsolescence programmée», créée par le riche philanthrope américain Bernard London pour sortir le pays de la grande dépression des années 30. – Le Pop Art et son chantre Andy Wharol qui, de sa Factory 3, n’a fait que glorifier le système – sous couvert d’en questionner les dispositifs – en rendant artistiques les produits qui colonisaient en masse nos sociétés et nos têtes, autrement dit en fétichisant la marchandise. Standardisation, sérialité, technologie et marchandisation : le spectacle et sa société à leur apogée.
De l’Art dans la ville à la ville Art : design moi des moutons !
L’art de la guerre
«Saint-Étienne, Capitale internationale du design». Pour ce faire, elle crée la Cité du design dans l’ancienne manufacture d’armes de la ville : 33 000 m2, trois ans de travaux pour un coût de 40,7 millions d’euros avec l’aide de l’État, la région et l’argent du contribuable. Un lieu en soi assez symptomatique de la continuation et du recyclage d’un certain savoir-faire morbide. Tel le fameux «Clairon» ou FAMAS (Fusil d’assaut de la manufacture d’armes de Saint-Étienne), et ses lignes ô combien designées pour répandre leur «démocratie», ou en maintenir l’existence aux quatre coins du globe. Au même titre que la technologie, le design est une continuation de la guerre, c’est-à-dire de la politique, par d’autres moyens, pour s’exprimer comme Clausewitz. Pourquoi irait-on, sinon, jusqu’à parler de Cité du design ? Et d’ailleurs que doit-on entendre par Cité du design ? Uniquement ce lieu qui se veut la vitrine d’une pratique particulière ou l’espace générale de la ville où cette pratique a lieu ? Donc de Saint-Étienne dans son ensemble, comme ville designée.
Réenchantons donc tout ça
Une chose est sûre, ce n’est pas gagné d’avance et c’est tant mieux. A l’instar de villes comme Marseille (capitale européenne de la culture 2013 (4)) où se conjuguent résistance et une certaine image collant à la peau qui obstruent les plus mégalos désirs des élites en place. «Redresser l’image de Saint-Etienne ? Il existe des défis plus aisés. Aujourd’hui encore, la préfecture de la Loire souffre d’une mauvaise réputation. Ville froide, ville noire, ville grise et austère, qui ne vaudrait guère le détour… Quelle que soit sa véracité, ce constat accablant demeure un lourd handicap. Surtout dans un contexte de concurrence entre les territoires. Qu’on s’en félicite ou qu’on le regrette, les villes sont en compétition lorsqu’il s’agit d’attirer des chefs d’entreprise, des touristes ou de nouveaux habitants. Et, dans cette bataille, l’image joue un rôle décisif» (5) Le design est donc bien à entendre comme une marque, un logo, mais aussi un médium et un cheval de Troyes. Dans le monde réseau et à l’heure de la transnationalisation du capitalisme, on nous somme de nous vendre et de nous associer pour mieux combattre contre des métropoles voisines, d’autres états ou d’autres régions du monde. Autrement dit, il s’agit bien d’une guerre dont l’un des principaux objectifs est de coloniser nos esprits et nos territoires. Qu’on se le dise toutefois : de cette guerre, nous n’en voulons pas, pas plus que nous ne voulons de ces nouveaux habitants qu’elle charrie avec elle, ces néo petits-bourgeois à forts revenus qui nous relégueront, volontairement ou non, à des fonctions subalternes. A force d’être designée, Saint-Étienne finira par ressembler à n’importe quel quartier d’une mégalopole telle que Shangai, c’est-à-dire par ressembler à rien ou à ce qui se fait maintenant presque n’importe où sur le globe, ce qui revient au même : «modernisation» disciplinaire d’un côté, muséification touristique de l’autre, et néantisation du vivant partout. Notre territoire est donc devenu le terrain d’un incessant conflit de basse intensité que nous nous devons de défendre ; non pour ce qu’il devrait être aux yeux de nos gestionnaires mais bien pour ce qu’il est et ce que nous en faisons au quotidien. Si nous nous battons, c’est pour conserver le peu de vie réelle qui y subsiste encore face à ce dessein mortifère qui nous est destiné. Et tous ces tours de passe-passe qu’on emploie, soit disant pour nous civiliser, ne parviendront pas à nous faire oublier les antagonismes de classe et les conflits sociaux en cours. Du nouveau logo de la ville au nouveau slogan pour se vendre au-dehors – «Saint-Étienne atelier visionnaire» –, Saint-Étienne s’est fait un petit lifting promotionnel. Sur le plan local, il s’agit de redorer un passé industriel glorieux (quitte à nier une grande part d’une certaine réalité économique et sociale qui lui est consubstantielle) en changeant par tous les moyens possibles et imaginables (communication, grands travaux, emprunts toxiques, participation citoyenne, accueil de grands événements...) cette image stigmatisante (6). Saint-Étienne tente de se rattacher à la mégalopole en cours de construction dans la région Rhône-Alpes, ou au minimum de s’y faire une place. C’est que pour peser dans la concurrence mondiale, il faut du nombre et de la technologie. C’est ce à quoi travaillent nos trois blaireaux socialistes régionaux (Messieurs Vincent, Collomb pour Lyon et Destot pour Grenoble) : donner à la région Rhône-Alpes une dimension internationale ou, au moins, une envergure européenne avec d’un côté la métropole Lyon-Saint-Étienne et de l’autre le Sillon Alpin (7). Quelle place peut alors jouer notre ville dans cette méga-technopole multipolaire, si elle ne veut pas être cantonnée à celle de banlieue dortoir pour la grande voisine qui a tout de même besoin d’elle pour étoffer son poids métropolitain ? Car il est vrai que même avec quelques pôles de compétitivité, Saint-é ne pèse pas bien lourd face à ses deux voisines. Son maire, dans une formule qui ne manque pas de force pour un slogan (est-ce de lui ou du service communication de la ville ?), en dit assez long sur le projet : «nous avons un savoir-faire et nous allons le faire savoir (8) ». Ce que Monsieur Maurice Vincent nous dit c’est que Saint-Étienne et son design feront surtout officine de propagande pour ses partenaires, la com’ de l’innovation (9). Et son intégration au club des villes patrimoine de l’UNESCO – réseau qui compte aujourd’hui onze villes créatrices (10) – lui offre à cet égard une certaine légitimité institutionnelle. Cependant, tout le monde voit bien que ce ramdam ne convainc pas tant que ça les habitants de cette ville. Quelle est dès lors la véritable fonction dudit ramdam ? Ni plus, ni moins de nous façonner captieusement l’esprit afin de nous acclimater à ce que nous prépare l’Ennemi : supporter l’insupportable, faire accroire la liberté dans l’absolue déshumanisation. Dans la plus pure novlangue, à créer du discours : parler de et faire parler. «La biennale produit des effets concrets : les nombreux articles qui ont été écrits sur le sujet témoignent d’une vraie reconnaissance. Cela donne une nouvelle image à notre ville et contribue à son attractivité (11).»
Bienvenue dans le nanomonde
« [L’homme a créé la machine]. La machine a envahi l’homme, l’homme s’est fait machine, fonctionne et ne vit plus. » – Mohandas Gandhi
La biennale, donc, nous parle du monde de demain. Si le design est né avec la première société industrielle, il témoigne aujourd’hui de la quatrième et dernière (12) révolution industrielle, celle de la convergence des sciences et des technologies NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno), qui se déploie sous nos yeux. Il nous parle de catastrophes à venir qu’il suffirait de conjurer par la grâce et l’intelligence des techniciens et gestionnaires de tous poils. Mais la catastrophe, elle, est belle et bien déjà là. Et même si l’humain, lui, s’adapte à tout – y compris au pire –, mieux vaut tout de même l’aider à banaliser encore celles à venir… sait-on jamais avec cet animal. Voilà donc des années que cette biennale nous fait la propagande de ce que concoctent les labos de Recherche et développement (R&D) pour répondre aux maux qu’ils créent. Et toujours sous couvert de création et de réflexion, on s’adonne à toutes les saloperies possibles et imaginables. Parmi les expositions bien révélatrices, telle «Eden-ADN» en 2007, ou certains stands bien craignos, la palme revient toujours au pavillon «aujourd’hui, c’est demain»… En pire.
Quelques exemples en vrac vus lors de cette biennale ou lors de précédentes : Artificialisation du vivant (OGM & biotechniologies) / Manifeste des mutants (13) / Prolifération de puces RFID et géolocalisation (14) / (Inter)connexion généralisée (des ondes électromagnétiques – et des cancers – à gogo) / Virtualisation du monde (où le virtuel tend à devenir le réel et l’écran notre unique fenêtre sur le monde) / Propagande nucléaire au stand EDF / De la nanotechnologie à toutes les sauces / Appareils intelligents (15) / Monde sans paysans (création de tours agricoles à production hors sol ; viande à faire pousser chez soi in vitro (16), capsules nutritives, … (17) – bon empathie !) / Comment vivre demain dans une boîte à chaussures ? (où mieux que les solutions proposées par le bienfaiteur de l’humanité Ikéa, les murs bougent et les objets se plient pour répondre aux besoins de la journée) (18) / Des super jeux éducatifs : «SIMS nanotechnologies» en lien avec le CNRS et le CEA (où en plus de réaliser son petit fantasme de démiurge du monde on profite des bienfaits des technologies telle l’introduction d’une puce sous-cutanée !) / Monde de robots / Recyclage des déchets industriels pour en faire des objets de consommation courante (utilisation du Cofalit, «pierre noire» issue de la vitrification de déchets amiantés du bâtiment rendus inertes grâce à la vitrification. A quand les objets radioactifs ?), etc, etc.
Des horreurs jusqu’à la nausée qui se dissolvent dans le décor, la marchandise et la magie (noire), et que pourtant personne ou presque ne semble vouloir questionner. Pour les quelques attentionnés et les plus critiques, ces monstruosités indiquent bien que le prochain champ de bataille sur lequel planchent moult organismes et concepteurs est bel et bien l’humain. Car après les objets et la nature inévitablement viendra notre tour.
Le design est une nuisance.
Seule sa disparition saura nous réjouir.
Le reste n’est qu’affaire de Béni-oui-oui
Collectif Manuela Rodriguez
– Juin 2013 –
1 - La 8ème biennale du design de Saint-Etienne (2013) avait pour titre « L’empathie ou l’expérience de l’autre ».
2 - Voir à ce sujet le texte Vaucanson, où le prototype de l’ingénieur, Olivier Serre, 2009 : < http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=198 >.
3 - La Factory (l’usine) et le nom de ses ateliers New Yorkais où il produisait ses sérigraphies en quantité industrielle.
4 - Pour une critique de cette manifestation, nous renvoyons le lecteur au pamphlet réalisé par des lillois (Lille fut capitale européenne de la culture en 2004) : La fête est finie, disponible à l’adresse suivante : < lafeteestfinie.free.fr/ >. Pour Marseille, quelques textes sont consultables sur le site Basse Intensité : < http://basseintensite.internetdown.org/ >.
5 - Saint-Etienne, l’heure de la reconquête, L’express, N°3218, mars 2013.
6 - Bienvenue chez les Ch’tiphanois, Jean-Pierre Garnier & Manuela Rodriguez, Article 11 N°10, juin-juillet 2012, disponible à l’adresse suivante : < http://juralib.noblogs.org/2012/07/29/bienvenue-chez-les-chtiphanois/ >.
7 - Le Serpent Alpin ou le saccage du territoire allobroge, Pierre Mazet, août 2007, < http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=109 >.
8 - L’express, op. cit.
9 - «La Biennale du design, véritable rendez-vous avec la modernité, fait partie des évènements qui s’inscrivent dans l’histoire de la ville. (…) et le monde entier qui vient car il voit une ville avec un nouveau visage, innovante… Ce n’était pas gagné d’avance ! Cette Biennale est la confirmation que nous avons juste lorsque nous avons décidé de nous lancer dans l’aventure du Design. Beaucoup étaient dubitatifs en 1997-1998 sur la nécessité d’un tel évènement. En 2006, je n’ai pas rencontré une seule personne qui m’ait dit qu’il ne fallait pas faire cette Biennale. Dans un contexte mondialisé, nos entreprises et leurs employés ont besoin de l’ouverture exceptionnelle qu’elle nous apporte.» Michel Thollière, Aujourd’hui Saint-Etienne, février 2007.
Sous le soleil de l’innovation, rien que du nouveau !, Pièces et main d’œuvre, juin 2012, < http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=378 >. Ce texte est également disponible en livre aux éditions L’échappée, février 2013.
10 - Kobe, Buenos Aires, Pékin, Shanghai, Séoul, Montréal, Nagoya, Berlin et Shenzhen.
11 - Michel Thollière (Maire de Saint-Etienne de 1994 à 2008 et sénateur de la Loire de 2001 à 2010), Aujourd’hui Saint-Etienne, Ibid.
12 - Dernière, puisqu’elle réactualise quotidiennement le concept de révolution. En ce sens, elle est liquide puisque rien ne se fige. Cf. La tyrannie technologique, critique de la société numérique, l’Echappée, 2007.
13 - Les Mutants sont la branche française des Transhumanistes. Ceux-ci prônent l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Pour en savoir plus sur La secte derrière les nanotechnologies : < http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=24 >.
14 - Stand «relationchip», espace relationnel, Vogt + Veizenegger (Allemagne) biennale cohabitation. Texte de présentation : « (…) RELATIONCHIP est une nouvelle forme de réseau entre le visiteur de la biennale. Vous êtes conviés dans ce lieu à échanger un de vos vêtements contre celui d’un autre visiteur, étiqueté avec une puce électronique [RFID en forme de cœur !]. (…) Vous pourrez obtenir des informations sur le nouveau propriétaire de votre ancien vêtement et suivre la chaîne que vous avez commencée sur notre terminal et une page internet.
15 - «(…) intelligence, il faut l’entendre au sens anglais de renseignement – comme dans «Intelligence Service» – c’est-à-dire d’information qui circule. Tous ces objets, infrastructures ou êtres vivants, pucés, deviennent communicants. Leur minuscule prothèse électronique collecte des milliards de données au fil de leur vie (sur nos comportements, nos habitudes, nos déplacements, nos relations, nos idées) et les transmet à d’autres supports numériques – les objets communiquent entre eux – ou à des bases de données dont le rôle est de stocker et d’analyser ces informations pour en tirer des capacités d’action – de l’intelligence.» in IMB et la société de contrainte, PMO, mai 2010 : < http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=253 >.
16 - Cf. Alerte à la biologie de synthèse et aux aliens de demain, PMO, 2013 : < http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=415 >.
17 - Et quel cynisme à l’heure des récents scandales alimentaires… «Pour faire accepter la viande artificielle, [proposition] d’une mise sur le marché progressive. Dans son scénario, la viande in vitro se présentera d’abord sous forme de poudre à utiliser comme un ingrédient parmi d’autres, dans la préparation du repas. Elle sera aussi intégrée dans les plats préparés vendus par les marques. Pendant ce temps, les chercheurs analyseront les réactions du public et ils feront évaluer cette viande in vitro afin qu’elle ne suscite plus de résistance chez les consommateurs». Projet In Vitro meat powder, projet Eating in-Vitro, 2012. Constenza Guiffrida, Next Nature Lab – Industrial Design Department, Eindhoven University.
18 - Où nous nous disons que vivre dans un conteneur paraît être quelque chose de très sain et de bien normal. Quant à sa généralisation, une évolution naturelle.
Pour lire ou imprimer ce texte en version mise en page et PDF, voir ICI, et ICI pour la version A5.

/image%2F1207906%2F20240303%2Fob_381b48_titre-blog-copier.gif)